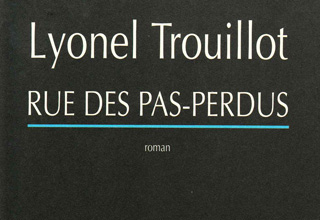Rue des Pas Perdus de Lyonel Trouillot (Éditions Mémoire, janvier 1996 ; Actes Sud, 1998)
Les citations en épigraphe sont, cette fois, d’Éluard (encore) mais aussi d’Allen Ginsberg et du poète créole haïtien Georges Castera. L’écriture, ici, se « spiralise » d’une part et, dans le même temps, on croit percevoir l’influence d’un auteur de la diaspora qui se fait sentir dans la structure de l’écrit : il y a sûrement du Émile Ollivier dans ces « pas perdus »... la technique qui consiste à confier alternativement la responsabilité du récit à la première personne du singulier, déjà rencontrée dans Passages, les broderies superposées sur un thème central : thèmes récurrents et énonciateurs croisés. Cette lecture brouillée peut parfois donner la sensation d’une absence d’unité. Mais on ne peut s’empêcher de ressentir profondément cette métaphore filée évoquant la vie quotidienne en Haïti.
Sur fond de bluette arlequine d’un narrateur non identifié mais fort épris d’une Laurence, Gérard -sorte de gourou d’un groupuscule se croyant révolutionnaire- parle et s’écoute parler : « Gérard ne parlait jamais seul à seul. Nous étions acteurs et témoins de cette chronique du dérisoire qu’il tenait par gourmandise ou par masochisme sans savoir s’il y croyait vraiment. » (p.39).
La scène se passe sous l’ère du « grand dictateur Décédé Vivant-Éternellement » et l’histoire la plus intéressante nous est racontée, à petites touches, par un chauffeur de taxi amoureux de sa Toyota. Une mère maquerelle sur le retour, qui n’a plus rien à perdre, nous dresse aussi un tableau vif de la société haïtienne :
« ... autrefois les gens de la haute ne manquaient pas de manières, d’extérieur, aujourd’hui, leurs manières c’est leur climatiseur, leurs cartes de crédit, voilà pourquoi les gens vivent ensemble, pour des climatiseurs et des cartes de crédit... » (p.49) dénonçant les « rastaquouères de discothèque qui vendraient leur mère à l’encan pour un week-end à Disneyland » (p.79), prédisant la victoire totale de la misère : « Et eux, comme des chiens errants qui n’ont plus de place pour errer parce que la misère prend toute la place et ne te laisse que des recoins, ils chassent les mouches avec des gestes que vous prenez pour des vivats, pour ne point perdre l’illusion de leurs bras, ils miment des airs de semence en attendant qu’un jour ils accourent demander justice à vos mensonges, à la faim. » (p.124). Même si toutes et tous sont morts autour d’elle.
Le plus proche de la vérité est le chauffeur de taxi, il connaît la ville dans le moindre recoin de son intimité, il connaît les gens dans tous leurs détails, c’est lui qui sait la valeur des avertissements : « Quand un officier te conseille de rentrer chez toi, en te laissant sa monnaie, c’est qu’il y a plein de chances qu’il soit déjà trop tard. » (p.44).
En compagnie de l’Étoilé, l’enfant des rues, il va en effet passer au ras de la mort, il perdra une jambe et un ami fou dans la pourriture d’un égout. Il égarera sa voiture bien-aimée mais s’accrochera de toutes ses forces à la vie. En fait, il est le véritable témoin, le seul crédible, il n’a aucun compte à régler, il aime la vie et les gens, il perd sa jambe comme il perdrait un ami, avec philosophie. Il perd sa voiture. Il perd tout, sauf l’espoir et c’est lui qui garde le mot de la fin. Il sait que le monde finit toujours dans la rue des Pas Perdus. Même si ce n’est plus lui qui conduit. Même si cette bonne rue des pas perdus est bien difficile à trouver dans le labyrinthe de la vie.
Philippe BERNARD