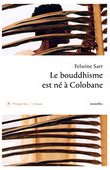Dimanche à 11h30, Vauban 1
Culture et développement
8 mai 2018.
Dimanche à 11h30, Cinéma Vauban 1
De peu de poids sont les mots du poète au regard de la dure réalité de l’économie, ironiseront les esprits forts. C’est tout le contraire : la prise en compte de la culture est la condition du développement. Et tout projet de développement ignorant la culture des populations concernées sera voué à l’échec.
Avec Érik Orsenna, Felwine Sarr, Michel Le Bris, économistes de formation, en dialogue avec Rémy Rioux, président de l’Agence Française de Développement, Patrick Chamoiseau, engagé dans l’élaboration d’un développement de Saint-Louis en Martinique et Jean-Christophe Rufin qui a travaillé dans l’humanitaire.

DERNIER OUVRAGE

Beaux livres
Il était une fois la Terre - La petite histoire et les mystères de notre planète
Gallimard - 2023
En 50 chapitres courts, Pierrick Graviou et Erik Orsenna offrent au lecteur une histoire de la Terre, de ses roches, de ses premiers occupants, de leur évolution, et enfin de l’humanité. « Il était une fois la Terre, bien avant la Terre… Car pour bien comprendre l’extraordinaire histoire de notre planète, il faut remonter aux origines de l’Univers, à la source de la matière.
Cette matière qui constitue notre sous-sol, l’eau, l’air, les plantes, les animaux, mais également le papier de ce livre, ses deux auteurs, ses lectrices et ses lecteurs. Il était une fois…
Voici donc une belle histoire, la mère de toutes les histoires. Attachez vos ceintures ! Le voyage que nous vous proposons va vous conduire loin, très loin, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’infiniment vieux à l’infiniment jeune… »
- « C’est un livre inattendu qui raconte la naissance de la Terre et qui réunit un géologue et un académicien. Cet homme, membre de l’Académie française, c’est le grand Erik Orsenna qui publie « Il était une fois la Terre » avec Pierrick Graviou, aux Editions Gallimard. Une terre qui a vécu de nombreux désastre climatique dans son Histoire avec la disparition de toutes les espèces vivantes par période. Sommes-nous les prochains dinosaures ? » France Inter
- « II a fallu près de cinq ans de travail pour y arriver. En 51 chapitres de deux à trois pages, c’est une aventure que l’on suit et pour laquelle on se passionne. Le scientifique a tout de même glissé quelques graphiques et schémas à la fin. Mais l’ouvrage s’adresse à tous les publics. » Le Trégor
- « Serge Bloch apporte sa sensibilité poétique à cette épopée comptable en milliards d’années. Des formes, des couleurs,des collages pour la raconter dans ce difficile équilibre de la liberté et de la rigueur. » DNA
- « Ce livre surprenant et ambitieux, qui raconte toute l’histoire de notre planète, du Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années, à aujourd’hui, en un langage clair et sans fioritures, a son charme. Un tel récit pourrait se prêter à des envolées lyriques, mais les auteurs ont choisi de rester factuels, se permettant seulement une touche d’humour à l’occasion – et on ne peut que leur être reconnaissant pour ce choix ! » Espèces
DERNIER OUVRAGE

Essais
Pour l’amour des livres
Grasset - 2019
« Nous naissons, nous grandissons, le plus souvent sans même en prendre la mesure, dans le bruissement des milliers de récits, de romans, de poèmes, qui nous ont précédés. Sans eux, sans leur musique en nous pour nous guider, nous resterions tels des enfants perdus dans les forêts obscures. N’étaient-ils pas déjà là qui nous attendaient, jalons laissés par d’autres en chemin, dessinant peu à peu un visage à l’inconnu du monde, jusqu’à le rendre habitable ? Ils nous sont, si l’on y réfléchit, notre première et notre véritable demeure. Notre miroir, aussi. Car dans le foisonnement de ces histoires, il en est une, à nous seuls destinée, de cela, nous serions prêt à en jurer dans l’instant où nous nous y sommes reconnus – et c’était comme si, par privilège, s’ouvrait alors la porte des merveilles.
Pour moi, ce fut la Guerre du feu, « roman des âges farouches » aujourd’hui quelque peu oublié. En récompense de mon examen réussi d’entrée en sixième ma mère m’avait promis un livre. Que nous étions allés choisir solennellement à Morlaix. Pourquoi celui-là ? La couverture en était plutôt laide, qui montrait un homme aux traits simiesques fuyant, une torche à la main. Mais dès la première page tournée… Je fus comme foudroyé. Un monde s’ouvrait devant moi…
Mon enfance fut pauvre et solitaire entre deux hameaux du Finistère, même si ma mère sut faire de notre maison sans eau ni électricité un paradis, à force de tendresse et de travail. J’y ai découvert la puissance de libération des livres, par la grâce d’une rencontre miraculeuse avec un instituteur, engagé, sensible, qui m’ouvrit sans retenue sa bibliothèque.
J’ai voulu ce livre comme un acte de remerciement. Pour dire simplement ce que je dois au livre. Ce que, tous, nous devons au livre. Plus nécessaire que jamais, face au brouhaha du monde, au temps chaque jour un peu plus refusé, à l’oubli de soi, et des autres. Pour le plus précieux des messages, dans le temps silencieux de la lecture : qu’il est en chacun de nous un royaume, une dimension d’éternité, qui nous fait humains et libres. »
- “Du grenier breton où le gamin plonge tête la première dans La Guerre du feu, jusqu’à la découverte en bibliothèque du Dernier des Mohicans et de Moby Dick, flibustiers et explorateurs, pionniers et cannibales sont réunis ici pour rappeler la puissance de la lecture sur un enfant solitaire.” Télérama
- “Ce nouvel opus est à la fois une autobiographie et un essai. Une ode à l’écriture et aux écrivains. Michel Le Bris fait de la lecture une nécessité, une urgence pour se construire soi-même. La littérature est aussi un engagement et une bataille pour la culture, essentielle à la démocratie.” France Inter
- "Pour l’amour des livres participe de belle manière à cet hommage choral que les écrivains ont rendu au fil du temps afin de s’acquitter de leur dette envers une littérature qui leur a tant apporté." Zone Critique
DERNIER OUVRAGE

Romans
Le vent du nord dans les fougères glacées
Seuil - 2022
« Boulianno Nérélé Isiklaire était espécial. Il savait des choses sur le profond du conte, sur la Parole qui demande majuscule, sur la lutte contre la mortalité… Il avait développé une connaissance de tout cela dans le secret de son esprit. »
Le dernier « maître de la Parole » qui, comme les bambous a sept vies et ne fleurit qu’une fois, va s’enfermer dans le silence. Il s’est réfugié dans les hauteurs de l’île, plus haut encore que les mornes où se sont développées les pratiques des veillées. Avant que son retrait ne soit définitif, un groupe espérant qu’il formera l’un des leurs, « le tambour Populo », et, de son côté, une toute jeune fille étrange et solitaire, surnommée « l’anecdote », partent sur ses traces pour qu’il choisisse l’héritier et lui donne en legs sa dernière leçon et le secret de sa poésie. Mais les deux jeunes gens s’associent. Ils vont retrouver, au prix d’innombrables exploits, trois cases successives…
Patrick Chamoiseau renoue donc, au bout de quinze ans, avec sa grande veine narrative riche en personnages inoubliables.
DERNIER OUVRAGE
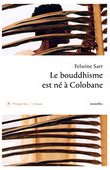
Nouvelles
Le bouddhisme est né à Colobane
Philippe Rey - 2024
Un homme intrigué par l’épuisement de son désir ; une amie disparue, qui, des décennies plus tard, libère son ancien amant de son attente ; une femme écartelée entre les élans du cœur et la raison familiale ; un musicien décédé brutalement dont l’absence rappelle à ceux qui l’ont chéri sa présence en eux ; un sage assis sur un banc pensant l’amour comme la « forge d’oubli du réel ».
Dans cette quête impossible d’un désir absolu et sans limites, les compositions musicales de Toumani Diabaté, Wasis Diop ou bien encore Cheikh Lô accompagnent Fodé, Teibashin et les autres personnages. La musique souligne alors l’amour et le manque, la passion dévorante qui ronge les hommes mais aussi les anime. Le bouddhisme est né à Colobane est une ode à la vie, un appel à « participer du mouvement, y consentir, se laisser traverser et métamorphoser… ».
De Dakar à Abidjan, de Nantes à Kaolack Ndangane, Felwine Sarr compose une partition singulière et vive, une ballade à l’intérieur des âmes humaines pour dire la vie et son inéluctable achèvement, l’amour et ses nuances. Dans une langue limpide, il enjoint aux hommes de se couler dans les rythmes et les sons de leur existence pour faire face à l’urgence
de vivre et d’aimer.