Avec E. TEMELKURAN, M. WEITZMANN, F. SARR, M. DELMAS-MARTY
Animé par Yann NICOL
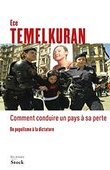
E. TEMELKURAN, M. WEITZMANN, F. SARR, M. DELMAS-MARTY
Avec E. TEMELKURAN, M. WEITZMANN, F. SARR, M. DELMAS-MARTY
Animé par Yann NICOL
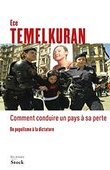
« Comment et pourquoi un populiste sans pitié, avec l’aide d’une bande de partisans toujours plus nombreux, a pu mettre fin à la démocratie turque au cours de la nuit du 15 juillet 2016 est une histoire longue et compliquée. Le propos de ce livre n’est pas de raconter comment nous avons perdu notre statut de démocratie, mais d’essayer d’en tirer des leçons au profit du reste du monde. Chaque pays, bien évidemment, s’inscrit dans un contexte qui lui est propre, et certains choisissent de croire que leur démocratie bien éprouvée et leurs solides institutions les protègent de pareilles « complications ». Toutefois, les similitudes, si frappantes, entre ce que la Turquie a traversé et ce que le monde occidental a commencé à vivre peu après, sont trop nombreuses pour être ignorées. »
Dans ce livre ambitieux, passionné et provocateur, Ece Temelkuran dissèque la montée du populisme dans le monde. Elle révèle les schémas et explore les causes profondes et les différentes façons dont les pays, mêmes les nôtres, peuvent sortir de la démocratie sans s’en apercevoir. Pour la journaliste, les soulèvements récents survenus en Turquie font partie d’un phénomène mondial qui doit servir d’avertissement aux pays occidentaux ayant encore la possibilité de rompre avec ce schéma. Puisant aussi bien dans sa propre expérience que dans l’Histoire, Ece Temelkuran expose une pensée clairvoyante et incisive pour la défense de la démocratie.

Et si la France était devenu le pays où la haine s’exerce, se déploie, et parfois assassine ? Le cœur d’un brasier qui, depuis la fin de la guerre froide, d’Alger à Varsovie, de New York à Moscou et Istanbul, menace la planète ?
La France a été en 2002 le premier pays occidental à mettre un leader populiste aux portes du pouvoir. Dans les années 2010, elle est devenue le premier pays d’Europe en terme d’envoi de djihadistes vers l’Irak et la Syrie. Depuis 2015 enfin, avec près de 300 morts, elle est numéro 1 en terme de victimes d’attentats majeurs, tandis que les agressions antisémites ne faiblissent pas...
Marc Weitzmann nous livre la première grande enquête « totale », factuelle, intellectuelle, historique, littéraire, qui tente de dénouer ces différents fils. Fruit d’un travail de quatre années, Un Temps pour haïr est fondé sur des écoutes des services secrets ; sur les compte-rendus de procès terroristes ; sur des rencontres avec les familles de djihadistes, des psychiatres, des enseignants ; sur l’analyse sémiotique des dialogues entre les équipes de tueurs ; mais aussi sur la reconstitution de chapitres méconnus de la colonisation et sur celle des réseaux d’extrême droite dans les années 1990.
Le livre, qui reconstitue le parcours de multiples personnages à l’épaisseur romanesque, frappe autant par l’ampleur du tableau qu’il brasse que par sa forme. Enquête sur la psychopathologie du djihad, plongée historique aux sources de la colonisation et réflexion personnelle se mêlent non pour apporter une explication dogmatique définitive mais pour guider le lecteur dans une méditation sur le rôle des images, de l’idéologie, la question de l’authenticité, des vérités simultanés. Aucune porte ne se tient devant nous – porte de la guerre ou de la paix qu’il suffirait de franchir ou de refermer – mais au moins serons-nous mieux armés pour comprendre…
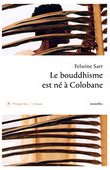
Un homme intrigué par l’épuisement de son désir ; une amie disparue, qui, des décennies plus tard, libère son ancien amant de son attente ; une femme écartelée entre les élans du cœur et la raison familiale ; un musicien décédé brutalement dont l’absence rappelle à ceux qui l’ont chéri sa présence en eux ; un sage assis sur un banc pensant l’amour comme la « forge d’oubli du réel ».
Dans cette quête impossible d’un désir absolu et sans limites, les compositions musicales de Toumani Diabaté, Wasis Diop ou bien encore Cheikh Lô accompagnent Fodé, Teibashin et les autres personnages. La musique souligne alors l’amour et le manque, la passion dévorante qui ronge les hommes mais aussi les anime. Le bouddhisme est né à Colobane est une ode à la vie, un appel à « participer du mouvement, y consentir, se laisser traverser et métamorphoser… ».
De Dakar à Abidjan, de Nantes à Kaolack Ndangane, Felwine Sarr compose une partition singulière et vive, une ballade à l’intérieur des âmes humaines pour dire la vie et son inéluctable achèvement, l’amour et ses nuances. Dans une langue limpide, il enjoint aux hommes de se couler dans les rythmes et les sons de leur existence pour faire face à l’urgence
de vivre et d’aimer.

L’humanité serait-elle entrée dans le « pot au noir », cette zone au milieu des océans où les vents qui soufflent en sens contraires se neutralisent ou se combattent ? Dans un monde pris dans ces tourbillons, entre paralysie et naufrage, où trouver la boussole qui permettrait d’en sortir ?
Pour échapper au désordre, stabiliser l’instable et penser l’imprévisible, il ne suffit pas de placer l’humanité et ses valeurs au centre du monde, comme a tenté de le faire la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Il faut réguler les vents autour de principes communs et inventer la boussole d’un humanisme élargi à la planète qui guiderait les humains sur les routes imprévisibles du monde.